À trop se laisser porter par le destin...
À trop se laisser porter par le destin, j’ai fini par marcher dans les chaussures d’un mort. Mon pantalon, tellement il est rapiécé que je ne sais combien l’ont porté. Il est devenu trop grand, à moins que moi, je n’ai trop maigri.
Je marche dans les chaussures d’un mort.
Quelle blague ! C’était un vendredi, il y a longtemps déjà, je ne sais plus, au début de ma déconfiture, une descente aux enfers. Jumaâ moubarak°, m’avait souhaité le barbu en accompagnant sa largesse de quelques pièces. Une paire de chaussures, celle d’un mort, raconta-il. Presque neuves et de bonne facture, du fait main, tout en cuir. De la part de la femme de mon ami décédé, compléta-t-il. Il me proposa également un dentier. Mais il me rappelait trop le rire de mon ami. Chokran bzef Sidi°, mes respectueux remerciements à ta sœur. Je pris les chaussures et m’en allais.
Pour les fringues, quand la baraka sourit pour me livrer quelques centaines de rials°, c’est jantiya°, le marché des frusques usagées qui s’étale sur une petite place près des remparts de la médina. S’tin rial°, s’tin rial ! crient les marchands pour ameuter les passants. S’tin rial, pourquoi s’en priver. Et puis, ce n’est pas comme si j’avais le choix, fini le centre-ville.
Le vendredi, je tends mon écuelle en bois, pour quelques cuillères d’un ta’am° partagé avec d’autres pauvres hères. Puis je déambule, mendiant par ci, racontant une histoire par là, au gré de mes vagabondages. Mais ce sont les enfants, lorsque leurs regards captivés par mes mimiques s’esclaffent d’un grand rire à la fin d’une histoire, qui font renaître en moi un regain de fierté perdue.
Je marche dans les chaussures d’un mort et l’hiver, la nuit tombe tôt, le froid aussi. Une fois, elles m’ont traîné jusque sous le porche chaud d’un quartier rupin. Ils m’ont viré, ce n’était même pas le matin. Ici, on ne veut pas d’un chien comme toi, ont-ils vociféré, poings levés et regards haineux. Décidément, je n’aime pas les rupins. Je préfère les pauvres gens, les prolos. Eux savent partager, même leurs nippes délavées et le reste d’un quignon de pain, un verre de thé.
Dès les beaux jours, à tinouitchi°, alors que le soleil enflamme l’océan, elles me portent sur la lande, loin en dehors de la ville, près de la plage. Je me perds dans le va-et-vient des rouleaux. Les jours de vents, je cours dans les embruns, riant comme un fou après les mouettes qui s’envolent.
Quand la nuit tombe, je fais un feu au creux d’un gros rocher, presque une grotte. C’est mon refuge, loin du bruit et des turpitudes de la vie. Alors que ma théière cabossée repose sur quelques braises, je sors mon kif et allume mon sibsi°.
Il rougeoie dans l’obscurité, douces volutes flottant dans l’air, une douce ivresse me gagne. J’aime cette odeur de kif, sa façon de m’investir, de calmer mes angoisses. Il fait partie de moi, il y a longtemps que je le côtoie, des lustres à vrai dire.
Il est un joyeux compagnon et j’aime qu’il me consume. Les nuits de pleine lune, comme les nuits noires, de celles où l’esprit s’évade vers ces étoiles filantes qui parfois illuminent le firmament, éphémères, comme les espoirs.
Là, contemplant les étoiles pour y perdre mes rêves, je voudrais tel le phénix des légendes, renaître de mes cendres. Et dans cette renaissance, ressentir en une belle harmonie, l’énergie de l’Univers et la beauté de la Nature.
Dans le crépuscule, il m’arrive de rêver d’une montagne solitaire. De hauts palmiers s’y balancent dans la douceur estivale d’un vent léger. Une caravane en descend, le désert semble proche, silencieux et vide, comme mon âme tourmentée.
Un jour, une après-midi, un orage éclata en grosses gouttes, inondant bientôt le trottoir et mes cartons, noyant dans le caniveau, papiers et mégots. Alors mon public se dispersa, comme la fin d’une belle promesse, une volée de moineaux au printemps
Sans aucun doute, un murmure d’automne qui s’esquissait à l’horizon. Le soleil s’enfuyait plus tôt que de coutume sous des éclairs zébrant un ciel indigo. La rue se vidait de gens trempés et pressés, emportant tout mon auditoire loin dans le crépuscule. Avec l’averse s’écoulaient tous mes espoirs, ceux d’un conteur vagabond mendiant son casse-croûte.
Dans les chaussures du mort, je regagnais la plage, le creux rassurant de mon rocher. C’était un soir d’automne, un orage de trop, peut-être. Les rouleaux rugissaient sur l’estran, le soleil déjà noyé dans l’océan.
Une grande ligne blanche dans un billet froissé, les notes d’un luth, rassurantes dans le lointain, flottaient aux confins de mon esprit. Maintenant, il se sent libre, libre et léger. Comme une feuille dérivant au gré du vent, vers une nouvel ailleurs. Mes yeux se tournent vers l’océan. Une ultime fois, le rire des mouettes dans les embruns d’une tempête qui se déchaîne.
À trop vouloir défier les chemins du destin, des éclairs illuminent mon visage détrempé, presque serein sous l’orage dégoulinant.
Des senteurs de jasmin et de menthe, c’est ce à quoi je pense lorsque j’ouvre les yeux. Des étoiles étincellent par myriades dans un ciel profond. La tempête est passée.
Une voix rassurante, féminine, cherche à me rassurer doucement en me souriant, soulagée. Elle écoutait mon histoire lorsque l’orage éclata. Comme bien d’autres fois, me confia-t-elle.
Elle fut une de mes étudiantes, avant ma déchéance, et m’avait reconnu un jour que je mendiais un encouragement sonnant et trébuchant à la fin d’un joyeux récit. Surprise par mon état quelque peu délabré, elle m’avait suivi, repérant les endroits où je m’installais, devenant peu à peu une fidèle auditrice dans l’anonymat de mon public, toujours en retrait. Pour ne point m’importuner, expliqua-t-elle. Elle m’expliqua également qu’elle habitait non loin de la plage, et m’ayant vu par hasard dans les parages à plusieurs reprises, elle avait plus ou moins deviné où j’avais installé mon campement. Un peu avant la fin de l’orage, elle avait décidée, accompagnée de sa jeune sœur, de me porter quelques couvertures et provisions.
Elles me virent de loin, courir comme un dément dans les vagues, pourchassant les mouettes en riant dans le vent, avant de m’écrouler dans l’écume ruisselante des vagues. Toutes les deux m’avaient tiré tant bien que mal sur le sable avant d’appeler pour me faire transporter chez elles, dans les vapes et grelottant.
Un silence s’installa, agréablement froissé par un vent léger traversant le jardin, nos regards se croisèrent. J’étais encore pétrifié de froid, l’esprit affolé, ne sachant que dire, encore moins que penser, désarçonné par tant d’égards pour un vagabond déjanté. Mortifié, le cœur chaviré, je ne savais pas encore si je devais la maudire ou la remercier.
Et puis ce sourire enjoué dans les effluves du jardin … Une joyeuse invitation à revivre. Une fois encore, comme un phénix légendaire, renaître à nouveau.
À trop se laisser porter par le destin, du coup, je marche dans des chaussures flambant neuves.
À trop se laisser porter par le destin, j’ai fini par marcher dans les chaussures d’un mort. Mon pantalon, tellement il est rapiécé que je ne sais combien l’ont porté. Il est devenu trop grand, à moins que moi, je n’ai trop maigri.
Je marche dans les chaussures d’un mort.
Quelle blague ! C’était un vendredi, il y a longtemps déjà, je ne sais plus, au début de ma déconfiture, une descente aux enfers. Jumaâ moubarak°, m’avait souhaité le barbu en accompagnant sa largesse de quelques pièces. Une paire de chaussures, celle d’un mort, raconta-il. Presque neuves et de bonne facture, du fait main, tout en cuir. De la part de la femme de mon ami décédé, compléta-t-il. Il me proposa également un dentier. Mais il me rappelait trop le rire de mon ami. Chokran bzef Sidi°, mes respectueux remerciements à ta sœur. Je pris les chaussures et m’en allais.
Pour les fringues, quand la baraka sourit pour me livrer quelques centaines de rials°, c’est jantiya°, le marché des frusques usagées qui s’étale sur une petite place près des remparts de la médina. S’tin rial°, s’tin rial ! crient les marchands pour ameuter les passants. S’tin rial, pourquoi s’en priver. Et puis, ce n’est pas comme si j’avais le choix, fini le centre-ville.
Le vendredi, je tends mon écuelle en bois, pour quelques cuillères d’un ta’am° partagé avec d’autres pauvres hères. Puis je déambule, mendiant par ci, racontant une histoire par là, au gré de mes vagabondages. Mais ce sont les enfants, lorsque leurs regards captivés par mes mimiques s’esclaffent d’un grand rire à la fin d’une histoire, qui font renaître en moi un regain de fierté perdue.
Je marche dans les chaussures d’un mort et l’hiver, la nuit tombe tôt, le froid aussi. Une fois, elles m’ont traîné jusque sous le porche chaud d’un quartier rupin. Ils m’ont viré, ce n’était même pas le matin. Ici, on ne veut pas d’un chien comme toi, ont-ils vociféré, poings levés et regards haineux. Décidément, je n’aime pas les rupins. Je préfère les pauvres gens, les prolos. Eux savent partager, même leurs nippes délavées et le reste d’un quignon de pain, un verre de thé.
Dès les beaux jours, à tinouitchi°, alors que le soleil enflamme l’océan, elles me portent sur la lande, loin en dehors de la ville, près de la plage. Je me perds dans le va-et-vient des rouleaux. Les jours de vents, je cours dans les embruns, riant comme un fou après les mouettes qui s’envolent.
Quand la nuit tombe, je fais un feu au creux d’un gros rocher, presque une grotte. C’est mon refuge, loin du bruit et des turpitudes de la vie. Alors que ma théière cabossée repose sur quelques braises, je sors mon kif et allume mon sibsi°.
Il rougeoie dans l’obscurité, douces volutes flottant dans l’air, une douce ivresse me gagne. J’aime cette odeur de kif, sa façon de m’investir, de calmer mes angoisses. Il fait partie de moi, il y a longtemps que je le côtoie, des lustres à vrai dire.
Il est un joyeux compagnon et j’aime qu’il me consume. Les nuits de pleine lune, comme les nuits noires, de celles où l’esprit s’évade vers ces étoiles filantes qui parfois illuminent le firmament, éphémères, comme les espoirs.
Là, contemplant les étoiles pour y perdre mes rêves, je voudrais tel le phénix des légendes, renaître de mes cendres. Et dans cette renaissance, ressentir en une belle harmonie, l’énergie de l’Univers et la beauté de la Nature.
Dans le crépuscule, il m’arrive de rêver d’une montagne solitaire. De hauts palmiers s’y balancent dans la douceur estivale d’un vent léger. Une caravane en descend, le désert semble proche, silencieux et vide, comme mon âme tourmentée.
Un jour, une après-midi, un orage éclata en grosses gouttes, inondant bientôt le trottoir et mes cartons, noyant dans le caniveau, papiers et mégots. Alors mon public se dispersa, comme la fin d’une belle promesse, une volée de moineaux au printemps
Sans aucun doute, un murmure d’automne qui s’esquissait à l’horizon. Le soleil s’enfuyait plus tôt que de coutume sous des éclairs zébrant un ciel indigo. La rue se vidait de gens trempés et pressés, emportant tout mon auditoire loin dans le crépuscule. Avec l’averse s’écoulaient tous mes espoirs, ceux d’un conteur vagabond mendiant son casse-croûte.
Dans les chaussures du mort, je regagnais la plage, le creux rassurant de mon rocher. C’était un soir d’automne, un orage de trop, peut-être. Les rouleaux rugissaient sur l’estran, le soleil déjà noyé dans l’océan.
Une grande ligne blanche dans un billet froissé, les notes d’un luth, rassurantes dans le lointain, flottaient aux confins de mon esprit. Maintenant, il se sent libre, libre et léger. Comme une feuille dérivant au gré du vent, vers une nouvel ailleurs. Mes yeux se tournent vers l’océan. Une ultime fois, le rire des mouettes dans les embruns d’une tempête qui se déchaîne.
À trop vouloir défier les chemins du destin, des éclairs illuminent mon visage détrempé, presque serein sous l’orage dégoulinant.
Des senteurs de jasmin et de menthe, c’est ce à quoi je pense lorsque j’ouvre les yeux. Des étoiles étincellent par myriades dans un ciel profond. La tempête est passée.
Une voix rassurante, féminine, cherche à me rassurer doucement en me souriant, soulagée. Elle écoutait mon histoire lorsque l’orage éclata. Comme bien d’autres fois, me confia-t-elle.
Elle fut une de mes étudiantes, avant ma déchéance, et m’avait reconnu un jour que je mendiais un encouragement sonnant et trébuchant à la fin d’un joyeux récit. Surprise par mon état quelque peu délabré, elle m’avait suivi, repérant les endroits où je m’installais, devenant peu à peu une fidèle auditrice dans l’anonymat de mon public, toujours en retrait. Pour ne point m’importuner, expliqua-t-elle. Elle m’expliqua également qu’elle habitait non loin de la plage, et m’ayant vu par hasard dans les parages à plusieurs reprises, elle avait plus ou moins deviné où j’avais installé mon campement. Un peu avant la fin de l’orage, elle avait décidée, accompagnée de sa jeune sœur, de me porter quelques couvertures et provisions.
Elles me virent de loin, courir comme un dément dans les vagues, pourchassant les mouettes en riant dans le vent, avant de m’écrouler dans l’écume ruisselante des vagues. Toutes les deux m’avaient tiré tant bien que mal sur le sable avant d’appeler pour me faire transporter chez elles, dans les vapes et grelottant.
Un silence s’installa, agréablement froissé par un vent léger traversant le jardin, nos regards se croisèrent. J’étais encore pétrifié de froid, l’esprit affolé, ne sachant que dire, encore moins que penser, désarçonné par tant d’égards pour un vagabond déjanté. Mortifié, le cœur chaviré, je ne savais pas encore si je devais la maudire ou la remercier.
Et puis ce sourire enjoué dans les effluves du jardin … Une joyeuse invitation à revivre. Une fois encore, comme un phénix légendaire, renaître à nouveau.
À trop se laisser porter par le destin, du coup, je marche dans des chaussures flambant neuves.
© Robert-Haïtam Péaud.
4 avril 2021.
Illustration: Celui qui passe. Christine Leger.

Date de dernière mise à jour : 23/10/2021
Ajouter un commentaire
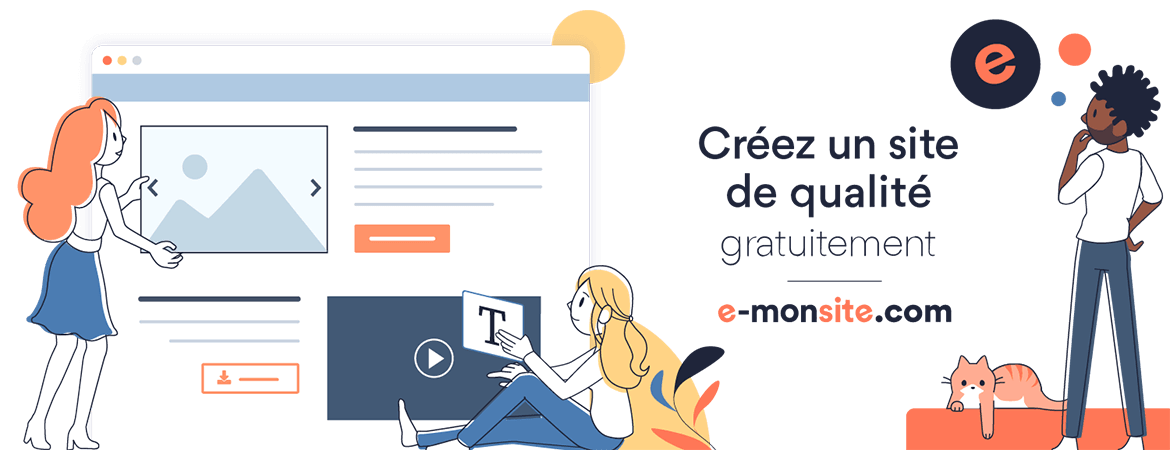
























 ème visiteur
ème visiteur