Tamchta de la Sylve.
Quelque part sur une côte du Vieux Continent.
An 178 des Grands Bouleversements…
- Krrrooââ, krrrooââ, krrrooââ !!!
Le cri malfaisant d’une corneille noire de jais me réveilla en sursaut. Toujours le même cri qui, depuis quelques temps, venait perturber mes nuits malgré les barrières mentales que Nalya, la Shaman du Clan des Érables, mon clan, m’avait appris à ériger. Elle semblait pourtant si réelle cette corneille, que je ne pus m’empêcher de regarder vers le haut du grand arbre dans lequel j’avais passé la nuit. Éclairé par la lumière d’Ayour, les quelques petites plumes noires que je vis voleter délicatement dans les airs pour se poser au sol me laissèrent néanmoins perplexe.

À l’est, la légère clarté qui transperçait doucement, indiquait que le lever du jour était proche ; d’ailleurs, je sentais que les quelques oiseaux qui nichaient dans les environs, ils étaient peu nombreux, s’éveillaient tranquillement pour saluer de leurs trilles joyeux l’arrivée de Tafouyt dans le ciel.
Dormant sur une grosse branche d’un arbre qui surplombait avantageusement les environs, je sautais aussi délicatement au sol depuis la branche où j’étais perchée, que les plumes du corbeau s’y étaient posées et me dirigeai prestement vers le petit torrent montagnard repéré la veille. Aux premières lueurs projetées par Tafouyt, le Dieu du Soleil, je vis la montagne et les ruines d’un village abandonné se farder de belles couleurs ocre. Saisie par ce spectacle, je fermai les yeux, imaginant des femmes s’affairant dans le matin en chantant alors que du toit plat des maisons montaient des rires d’enfants, l’entrain des hommes allant à leurs champs, poussant devant eux des ânes réticents à quitter la fraicheur de leur enclos pour affronter la chaleur écrasante qui régnait depuis des années dans cette rigueur montagnarde. Maintenant, les feux sont éteints, comme les chants et les rires, seul restait la source insuffisante de ce torrent minuscule.
Hormis les abords du petit cours d’eau qui offraient une végétation relativement dense, tout autour démontrait l’aridité de ces lieux désolés, seuls quelques arbres aux racines profondes et des touffes buissonneuses semblaient s’y être acclimatés. Je notai mentalement les restes de canaux d’irrigation qui devaient alimenter les cultures, peut-être alimentaient-ils également en eau potable le village bâti en terre ocre dont on ne voyait plus que des ruines en contrebas, tout près de ce qui autrefois devaient être de luxuriants jardins. Certains des murs, à demi écroulés, affichaient encore les marques d’impacts de tirs. Ce type d’armes est presque inconnu pour moi, elles avaient pratiquement disparues bien avant ma naissance seulement une vingtaine d’années après la transformation de la Vénérée Argana. Dans l’immédiat, je choisis de me reposer auprès du torrent et à l’ombre des quelques arbres qui y poussaient. La nuit sur une branche, même confortable, n’avait pas fait disparaitre totalement la fatigue de la traversée ni la marche effectuée la veille sous une chaleur à laquelle je ne suis pas vraiment habituée. Tout comme les bateaux d’ailleurs. Je m’étais sentie perdue sur cette immensité mouvante que mon estomac avait eu du mal à accepter. La seule immensité que j’avais connue jusque là était celle de la canopée lorsque nous escaladions des érables géants pendant l’entrainement ; nous avions alors l’impression de dominer le monde. Autant les sentiers sous les arbres peuvent paraitre silencieux à qui ne sait entendre, autant la canopée, elle, est emplie du chant des innombrables oiseaux colorés, des bourdonnements de guêpes et de papillons qui l’habitent et s’activent au sommet de ces arbres gigantesques que nous vénérons et respectons.

Longue et effilée, l’embarcation était confortable bien que spartiate. Elle était surmontée d’un mât à la voile carrée et une rangée de rames en sortait de chaque bord. La sculpture d’un étrange animal féminin en ornait la proue, un bonhomme, qui ne semblait pas être un de ces grands gaillards blonds et barbus pour la plupart qui composaient l’équipage, m’expliqua qu’elle était la représentation d’un être mythique appelé une sirène par les gens des Îles du Nord. Au fil de la discussion que j’entamais alors avec lui, je n’eus pas l’impression qu’il ne fût pas surpris outre mesure que je vinsse de la Grande Sylve. Les allusions qu’il en faisait, ses petits sourires en coin et ses yeux malicieux laissaient transparaitre qu’il en avait même une grande connaissance. Toujours est-il que ces marins du Grand Nord, même s’ils l’appelaient familièrement le Vieux, lui marquaient un grand respect.
Toujours est-il aussi que de fil en aiguille, ses questions à mon encontre devinrent plus précises, et je m’aperçus au bout d’un moment que je lui parlai comme à un vieux grand-père que j’aurais toujours connu. Et la raison pour laquelle je me trouvais sur ce bateau du Nord, je ne pus lui expliquer, en fait je n’en savais trop rien moi-même. Je ne sais pourquoi non plus, je lui dis ce que j’avais raconté à Nalya, et là, j’aurais juré qu’il la connaissait. Alors je lui narrai qu’une nuit, Ayour était pleine je me souviens, une grive s’est posée juste à côté de moi, sur une branche. Sur le moment, je n’y avais pas vraiment prêté attention, j’étais à l’affût d’un gibier, arc bandé, un marcassin en ligne de mire, que tout à coup, un tiptiptip tiptiptip impertinent fit fuir ma proie surprise par ce trille intempestif.
- Tu as mieux à faire que perdre ton temps à chasser cet animal, petite sœur, fit la grive en balançant légèrement la tête.
- Je ne le perds pas, je chasse pour le clan, répondis-je au tac au tac.
Et voila que tout à coup, je comprenais le langage des oiseaux ! Du moins d’une grive. Je me rendis alors compte, à mon grand étonnement, que ses paroles (?) pénétraient directement mon cerveau.
- Et, t’aurait-elle sifflé autre chose ? demanda le Vieux.
- Oui, que je devais me préparer à faire un voyage, lui répondis-je surprise de lui dévoiler aussi facilement cette rencontre avec l’oiseau alors que j’avais juré à Nalya de n’en parler à qui que ce soit.
Les marins s’étaient mis à la rame et nous entendions nettement leurs chants rythmés par une grosse percussion. Le Vieux me dit que c’était des chants traditionnels du Nord, des joïks, et que dans le temps passé, seuls les shamans les connaissaient. Mais le monde avait changé.
- Et la grive, ou peut-être la shamane Nalya, m’asséné-t-il tout d’un coup – je n’avais prononcé son nom, ne n’ont-elles rien indiqué d’autre sur le but de ce voyage mystérieux ?
Je commençais à me sentir agacée de ce qui était pour moi un inhabituel déluge de questions, perdue aussi sur ce bateau inconnu. Et puis ce vieux à l’allure bizarre : bonnet coloré formant comme une capuche posé négligemment sur de longs chevaux tressés dont la couleur hésitait entre le châtain foncé et le gris ; le visage, encadré d’un collier de barbe taillé ras, était un peu triangulaire, le front légèrement ridé et le nez droit, le teint basané indiquait une habitude des grands espaces, tout comme les habits par ailleurs... Tunique jaune arrivant à la taille et pantalon marron assorti, auquel était accrochée une ceinture supportant un poignard et une machette, bottes de marche en cuir souple. Il était également revêtu d’un long cache poussière à la couleur indéfinissable, sinon qu’elle semblait épouser celle du paysage pour s’y fondre. Impossible de lui donner un âge avec certitude, parfois, il paraissait vraiment très vieux avec son drôle de bâton orné d’une pierre étrange, aussi vénérable que les Grands Shamans de la forêt. De son bagage, un sac en cuir étanche pouvant se porter en bandoulière ou sur le dos, dépassait le manche d’un instrument de musique que je ne connaissais pas. Vraiment un drôle de bonhomme.
 - C’est un guembri, m’expliqua-t-il alors que je le regardais. Un vieil instrument que seuls quelques maitres artisans savent encore fabriquer. Ils viennent d’une très ancienne tribu d’Ifriqiya, les Gnawas, mais les adeptes du Grand Shaïtan et de la Vrai Foi les ont pourchassés implacablement après la Grande Pandémie. Ils n’aimaient par leurs chants et encore moins leurs danses rituelles qui faisaient communier des villages entiers en vénérant Pacha Mama. Comme nous tous si nous ne prenons pas garde, et la Sylve aussi.
- C’est un guembri, m’expliqua-t-il alors que je le regardais. Un vieil instrument que seuls quelques maitres artisans savent encore fabriquer. Ils viennent d’une très ancienne tribu d’Ifriqiya, les Gnawas, mais les adeptes du Grand Shaïtan et de la Vrai Foi les ont pourchassés implacablement après la Grande Pandémie. Ils n’aimaient par leurs chants et encore moins leurs danses rituelles qui faisaient communier des villages entiers en vénérant Pacha Mama. Comme nous tous si nous ne prenons pas garde, et la Sylve aussi.
- Pourquoi me dites-vous cela, vous qui semblait nous connaitre ? La Sylve est protégée par l’esprit de la Vénérée Argana, non ?
- Oui, bien sûr, mais pour combien de temps encore si le destin ne s’accomplit pas. Ton destin.
- Mon destin !!! Fis-je incrédule.
- Oui, ton destin, ma fille, regarde, il est inscrit en blanc par les étoiles. Tout comme ton voyage, c’est cela le destin que tu dois accomplir.
Prise dans les paroles du vieux bonhomme, je ne m’étais même pas aperçu que la nuit était tombée. Je distinguais le rivage tout proche, mon cœur se mit à battre la chamade dans ma poitrine. J’allais me retrouver seule, dans un monde inconnu, sans savoir pourquoi.
- C’est le moment Vénérable, c’est là que la Sylve doit débarquer.
Presque deux jours étaient passés. Je décidai alors de regarder ce que le vieux bonhomme m’avait donné en me souhaitant bonne marche, il n’avait pas l’air de rigoler. Presque compatissant et attendri. J’avais dû le rassurer en lui montrant mon poignard, ma longue dague et ma sarbacane. Il avait paru un peu soulagé. Non, je rêve. Néanmoins, et je ne sais toujours pas pourquoi, je ne lui parlai pas de la fléchette de Nalya. Était-elle le but de mon voyage ? Nalya me l’avait juste donnée en me disant qu’elle pouvait me prémunir de la corneille. Mais une était prête car le poison avec lequel elle était induite est aussi long et compliqué à confectionner que la fleur dont il provient est difficile à trouver. Cachée au plus profond de la forêt, on l’appelle la trompette d’ange, ou fleur du shaman, car eux seuls ont le droit de la cueillir et savent l’utiliser.
- De plus, a-t-elle complété, j’ai protégé la fléchette par des incantations shamaniques.
- Ne t’inquiète pas Tamchta, quand tu verras, tu sauras, m’avait-il en guise d’adieux en me tendant une amulette censée me protéger d’une corneille et d’une carte dessinée sur un parchemin, un travail magnifique, pas ailleurs. N’aie plus peur de la corneille, mais écoute la grive, elle viendra te voir un jour. Il connaissait même mon nom !
Et les matelots avaient souqués ferme vers la plage avant que la mer ne se retire trop.
L’amulette, je décidai de la passer autour de mon cou sans attendre, si je l’avais mise la veille, j’aurai peut-être été réveillée plus agréablement. Quant à la carte, elle m’indiquait où j’étais. Un point près de l’océan, un autre au nord-est dans les terres… D’est en ouest, formant deux arcs, un se dirigeant est nord-est, le second et le sud-est, pour se rejoindre très loin à des semaines et des semaines de marche vers Machrek, mentionnait la carte. Au milieu, un désert appelé le Désert de la Mer du Milieu. Au sud était une grande chaîne aride et pratiquement désertique. Et c’est encore plus au sud que s’étendaient les dunes de sable et les monts arides du Désert Infini. C’est en franchissant cette immense étendue que ses rudes habitants nommaient le Vide avec des caravanes que l’on rejoignait Ifriqiya autrement qu’en affrontant les dangers de l’océan.
Bien des années après, me rappelant, entre autres, cette anecdote, j’en conclurai que le Vieux, comme je l’appelais maintenant avec déférence, n’était pas sur ce bateau du Nord uniquement par le fait du hasard.
Je commençais à avoir faim et j’avais presque terminé les provisions que les Nordiques avaient consenties à me pourvoir par son entremise, décidément, même en colère contre lui, je n’arrivais pas à l’appeler le vieillard. Quant au pain consistant de la sylve que j’avais amené, il était épuisé depuis longtemps.
La il-ah ill-al-laaah !°
Achhadou anna Mohammed rasul laaah !
Hayya al-salaaah !
Hayya al-falaaah !
Allaaah ou Akbar !
Allaaah ou Akbar !
La il-ah ill-al-laaah
Cette psalmodie retentit soudain dans l’air et je conclus qu’elle provenait certainement des environs des ruines du vieux village. J’avais chaud et regrettais déjà la fraicheur du torrent, je pensais à Thlaloc, un dieu ancien de la pluie que la shaman Nalya invoquait parfois dans l’ombre de la Sylve. J’arrivais près des ruines avec d’infinies précautions pour constater que ce chant dont j’apprendrai beaucoup plus tard les paroles, provenaient d’au-delà une colline rocailleuse à la couleur ocre située derrière le village.
Ce que je découvris alors ma stupéfia, une minuscule oasis dont je n’avais pas devinée l’existence la veille, abritait des animaux et des hommes bien étranges. Tout de blanc vêtus et la tête savamment enturbannée, des hommes entravaient rapidement des animaux pour les décharger. Nantis d’une bosse dorsale, ils avaient un long cou recourbé qui se terminait par une tête allongée à la bouche et aux sinus proéminents. Si certains étaient bâtés, d’autres, surmontés d’une selle avec un ados, étaient pourvus de riches harnachements. Je distinguais également des chevaux à la belle allure. De grands arbres dépourvus de branches et à la cime parée de palmes se balançaient doucement dans la faiblesse du vent. L’atmosphère semblait irréelle, le soleil presque couchant la nimbait d’une teinte orangée dans la poussière et les cris qui se partageaient l’espace alors qu’un deuxième appel, cela me sembla en être un, retentit. La majorité des hommes à l’exception de quelques adolescents, tirèrent des tapis de leurs selles et nus pieds, se prosternèrent à plusieurs reprises vers l’est en récitant doucement des paroles. Aucune femme n’était pour l’heure visible. Habillés de tuniques et pantalons amples en plus de leurs longs turbans, tous ou presque affichaient une lame large et recourbée accrochée dans le dos et un grand coutelas à la ceinture alors que des arcs courts étaient s’affichaient sur les selles. Le fin collier de barbe que la plupart d’entre eux arborait, accentuait un air aussi fier que farouche.
 J’eus à peine le temps de me demander comment me joindre à eux, le Vieux m‘avait concocté une petite histoire et indiqué les salutations à respecter, qu’un cri d’alarme désignait l’intruse que j’étais. Je fus amenée dans une tente ronde en peau dans laquelle plusieurs femmes s’affairaient à préparer un repas dont les odeurs excitèrent atrocement ma faim. Une de ces femmes s’adressa à moi dans le langage commun du Vieux Continent et me proposa de l’eau.
J’eus à peine le temps de me demander comment me joindre à eux, le Vieux m‘avait concocté une petite histoire et indiqué les salutations à respecter, qu’un cri d’alarme désignait l’intruse que j’étais. Je fus amenée dans une tente ronde en peau dans laquelle plusieurs femmes s’affairaient à préparer un repas dont les odeurs excitèrent atrocement ma faim. Une de ces femmes s’adressa à moi dans le langage commun du Vieux Continent et me proposa de l’eau.
- Venez vous abriter dans notre tente commune, l’Amrhar est absent pour le moment, mais il vous recevra dès son retour, me rassura-t-elle. L’hospitalité du Vide est sacrée, compléta-t-elle à mon intention alors que je faisais attention de ne pas boire trop vite l’eau offerte.
Au bout d’un certain temps, confortablement installée dans la tente, je me sentis à la fois reposée et rassurée, nulle agression ni parole déplacée envers moi tout au contraire, l’accueil était chaleureux, déférent malgré l’impatience que j’éprouvais même si, prévenantes à mon encontre, elles devançaient le moindre de mes désirs. De plus, j’avais cru comprendre, chose incongrue pour moi qui avais appartenu à un ordre féminin, que celles-ci vivaient séparées des hommes, d’ailleurs, lorsqu’un d’eux arrivait, elles disposaient vite une petite voilette sur leur visage. Pourtant, leurs peaux basanées et leurs yeux noisette pour la plupart, affichaient un regard qui n’avait rien à voir avec la soumission. Toutes portaient une tunique sans manche aux couleurs vives qui les couvrait jusqu’aux pieds et leurs bras et poignets arboraient de nombreux bracelets multicolores. Leurs longs cheveux bruns étaient dissimulés par un foulard artistiquement disposé et de grands anneaux en bois teinté décoraient leurs oreilles découvertes. D’allure farouche, elles étaient moins nombreuses que les hommes dans le campement ; je notai mentalement qu’il y n’y avait aucun enfant, seulement quelques adolescents mâles munis de grands bâtons et au vu de leurs jeux, ils les maniaient avec dextérité.
Elles m’installèrent tout en plaisantant, pour palier mon impatience (?), sur des coussins entourant une table basse disposée dans un coin de la tente. Elles me servirent alors un rafraichissement, le jus orangé d’un fruit inconnu au goût frais et exquis, puis, pour faire assouvir un peu mon ventre qui grognait, une pâte confectionnée appelée harjira, je l’apprendrai ensuite, avec du lait de chèvre et des dattes séchées et concassées que l’on pouvait mélanger avec une céréale. Tout en dégustant cette agréable collation, mes sens de guerrière furent soudain en alerte, hormis les ruminements des animaux, tout paraissait très calme, trop calme. Je m’aperçus en regardant attentivement que, contrairement à mon arrivée quelques temps plus tôt, peu d’hommes vaquaient dans le campement alors que nous étions déjà en fin d’après-midi, comme si peu à peu, ils s’étaient éclipsés. Tendues à mesure que les ombres s’allongeaient, les femmes semblaient guetter ou pour le moins s’attendre à un évènement, je me rappelai soudain que je n’avais pas vu de chevaux alors que dehors des selles de qualité trônaient sur des râteliers. Mon expérience d’ombre guerrière, mon intuition aussi, me disait que quelque chose allait se passer. Les grognements des animaux se firent tout à coup plus sonores, nerveux. Tout à coup, dans un vacarme assourdissant, une espèce de chose inconnue, puis plusieurs, ce n’était pas animal, bondirent par-dessus la crête d’une dune de sable bordant le camp au sud et atterrirent en s’immobilisant à une vingtaine de mètres du cercle décrit par les tentes dans un énorme nuage de poussière qui fit s’égayer ceux qui flânaient dans le campement. Une étrange créature en descendit ; posée sur son épaule droite, une corneille noire émit un croassement maléfique. Un déclic se fit en moi, les trilles d’une grive, d’un élan instinctif et rapide, je saisis ma sarbacane, y inséra la fléchette et tira sans pratiquement viser. Au moment où la corneille, touchée en plein poitrail, s’écroula paralysée dans un ricanement malfaisant qui se transforma en un cri de douleur intense avant qu’elle ne disparaisse dans l’air, un morceau de son âme errant à jamais, solitaire dans le silence du Vide, une bande de cavaliers armés d’arcs courts et de lances fondit sur ce qui était en fait des engins datant des temps de la Grande Pandémie, tout en les encerclant. Tout en sortant de leurs machines sur chenilles, certaines des attaquants essayèrent néanmoins d’utiliser leurs armes et furent aussitôt abattus. Les femmes du camp explosèrent en youyous alors que des hommes, oui, cela en était bien, sortirent de leurs monstres immobilisés, leurs armes soudain inutiles face à la troupe déployée et déterminée à défendre ses biens et ses troupeaux face aux pillards.
De ma vie, et pourtant Pacha Mama sait que la Sylve est métissée, je n’avais vu de tels gens. Surtout aussi gros et surtout aussi blancs de peau. Comme si Tafouyt ne leur avait jamais accordé ses bienfaits et sa lumière, qu’ils avaient passé leur existence enfermés dans la mi-pénombre d’une grotte profonde. Pas très grands, avec leurs verres ronds et épais posés sur les yeux pour se protéger de la lumière du soleil, ils me firent penser à ces créatures aux yeux globuleux et à la peau presque translucide qui habitent les endroits les plus sombres et les plus reculés des profondeurs de la Grande Sylve. Des êtres malfaisants et dangereux que nous pourchassions inlassablement avec les guerrières de mon ordre.
Alors que des hommes parquèrent les intrus dans un enclos, mes compagnes de la tente m’entrainèrent dans une espèce de case en terre sèche de laquelle s’échappait un nuage de vapeur qui dégageait une odeur apaisante. L’Amrhar allait bientôt me recevoir me dirent-elles, riant entre elles avec des sourires de connivence, heureuses pour moi de cet honneur.
Un ingénieux système chauffait l’eau puis l’amenait au milieu de la pièce dans un vaste bassin bordé de siège en bois dur. L’on y entrait une fois que la vapeur l’avait emplie. L’on me déshabilla, me lava et me frotta la peau jusqu’à ce qu’elle devienne presque écarlate, et c’est peu dire dans mon cas. Dûment coiffée, à leur grand étonnement mes oreilles n’étaient pas percées, et habillée d’une belle tunique jaune rehaussée d’un beau vert, l’on ne se présentait pas en arme devant l’Amrhar, je fus conduit devant lui par celles qui étaient devenues presque des amies, j’étais de nature méfiante.
Sur le moment, je n’eus pas le temps d’admirer la riche décoration de la tente, dès qu’il leva vers moi son regard dont les yeux me rappelèrent le vert profond de la forêt, un chant de grive éclata dans ma tête. Je sus, je compris, là, sous cette tente perdu dans l’immensité rocailleuse des confins du Désert de la Mer du Milieu, le but de mon voyage. Mais n’était-ce que cela ? Une chose me taraudait, pourquoi la fléchette ? Tu le sauras, avait expliqué la shaman.
Je ne m’attarderai pas sur la soirée qui suivit, elle se déroula autour de mets et de saveurs que je ne soupçonnais pas, la vie d’une ombre guerrière est plutôt simple et spartiate, j’étais de plus totalement subjuguée par l’aura et la magnificence du regard de l’Amrhar. Après tout, ce qui se passa par la suite, concerne une intimité et une pudeur que jusqu’à présent, je ne pensais pas posséder. La farouche vierge guerrière que j’étais n’existait plus et une nouvelle vie s’ouvrait devant moi, Tamchta de la Sylve. Je m’attarderai donc davantage sur ce qu’Afalku me confia durant la soirée et les jours suivant le départ de la grande caravane dont je fais maintenant partie.
- Il y a très longtemps, une nuit où la lune était pleine et le ciel empli d’étoiles brillantes, j’avais rêvé d’une grive. J’étais encore adolescent mais je me souviens très bien du vent doux qui flottait dans les palmiers, les espèces de grands arbres sans branches, et quelque part dans la nuit, une flûte égrainait ses notes tendres lorsqu’une grive se posa près de moi pour me dire que la Femme du Destin allait venir et qu’il serait accompli. Elle me parla également d’une corneille maléfique qui veut empêcher le Destin de se construire. A priori tu l’as détruite. - Non, Seigneur, lui dis-je, je choisis la déférence due à son rang comme me l’avait conseillé le Vieux, cette corneille est l’incarnation d’une très vieille sorcière, une sorcière d’avant la Grande Pandémie à qui je n’ai fait qu’arracher une partie de son âme, malheureusement.

Puis soudain, sans attendre, comme s’il ne voulait plus évoquer la sorcière, il me parla de sa vie. Il me confia alors qu’il s’appelait Afalku, le Faucon du Désert, et qu’il descendait d’une grande lignée de Targuis, les hommes libres du Vide. Son clan, le Clan de la Grande Hamada, était établi dans l’oasis de Bouméké et il en était l’Amrhar depuis la mort de son père, et comme lui, il avait été élu chef pour cinq ans à la fois pour ses compétences de guerrier et ses connaissances de chef de caravane. Comme les siens autrefois, il vivait du commerce caravanier, transportant et troquant aussi bien des pains de sels provenant de mines au-delà du désert que des dattes ou des légumes récoltés et séchés dans l’oasis de Bouméké que du fromage sec, des céréales, parfois du tissu ou des bijoux, jamais d’armes. S’ils étaient armés, c’était uniquement pour se protéger des raids des Démons Blancs qui volaient du bétail, parfois des jeunes gens, particulièrement des filles. Mais pire que les Démons Blancs il y avait les adeptes d’Iblis al-Shaïtan, l’autoproclamé Dieu Unique, qui se sortaient de plus en plus souvent hors de leur Émirat de la Vraie Foi pour répandre leur parole et tuer ceux qu’ils appelaient les mécréants, les non-croyants. Soit ils soumettaient, soit ils pillaient les villages récalcitrants, pillant et violant les femmes avant de mettre le feu aux habitations et aux champs. Pour les Targuis, descendants des anciennes croyances gnaouas et soufies, les Fous de Shaïtan et leurs pratiques étaient des ennemis héréditaires, car si les uns prônaient la lumière et l’amour de Dieu et du prochain, les autres étaient élevés à l’ombre de sa crainte, dans la haine de l’autre et la soumission absolue des femmes.
Il évoqua ensuite son enfance dans l’oasis de Bouméké coincée entre une mer dont les vagues sont des dunes de sable et un reg caillouteux, la Grande Hamada dont l’entrée se distingue par de grosses roches arrondies, empilées les unes sur les autres en bordure de l’oasis dans un équilibre surnaturel et qui prennent des teintes ocrées au coucher du soleil. Il parla aussi de ces premiers apprentissages dans la vie d’homme du désert : savoir reconnaitre les empreintes des dromadaires du troupeau au cas où ceux-ci se perdraient ; savoir recoudre une outre en peau de chèvre, une question de survie, parfois. Et outre la connaissance des sources et l’entretien des dromadaires auxquels j’étais maintenant accoutumée, il avait appris à lire le grand livre du désert, à savoir apprécier le vent dominant qui module les dunes, oriente les vaguelettes et les plis du sable dans une direction précise, à s’orienter la nuit en regardant les étoiles, et tant d’autres choses encore, comme se méfier des djinns malfaisants et lubriques, qu’un Targui doit connaitre pour survivre dans un milieu aussi aride et hostile, où la soif tenaille sans cesse jusqu’à la mort l’imprudent qui se perd.
Il m’apprit également que les Targuis appelaient leurs prisonniers, ces hommes pâles que la lumière de Tafouyt aveugle, des Démons Blancs. Ce terme me disait quelque chose et il me semblait bien que les marins du Nord l’avaient mentionné à plusieurs reprises, mais, prise dans les questions du Vieux, je n’y avais pas porté attention sur le moment.
- Ces gens-là, m’avait raconté Afalku, les Démons Blancs, s’étaient enterrés volontairement, en famille ou en groupe, dans des abris souterrains leur servant de refuges et d’habitations, les bunkers, parfois dans des grottes aménagées et fortifiées bien avant la Pandémie et les Grands Bouleversements qui suivirent. Ils voulaient à la fois se protéger de l’insécurité du monde, d’armes maléfiques diffusant des gaz mortels, des calamités naturelles ou pas qui balayaient alors la planète, des adorateurs de Shaïtan qui proliféraient partout. Ils se méfiaient de tout et de tous et voulaient préserver le culte d’un ancien prophète crucifié ainsi que la pureté de la race blanche. Sur armés, ils avaient stockés des vivres et des munitions, du carburant pour leurs machines dont certaines ne fonctionnent et arrivaient à communiquer entre eux, mais ça, on a jamais trop compris comment. Mais à force de se reproduire entre eux dans leurs bunkers, ils ont dégénérés puis le manque de vivre et de carburant les a fait sortir de leurs tanières pour commettre des razzias où ils enlèvent aussi bien des animaux que des hommes, des femmes ou même des enfants, nous ont raconté des prisonniers. Qu’en font-ils ? L’on ne l’a jamais su, ils ne veulent pas le dire ou ne peuvent pas ils tiennent tous des propos incohérents, et je ne suis pas un tortionnaire, mais nous n’en avons jamais retrouvé de vivant. Il n’est pas étonnant que la sorcière dont tu parles ait pu les assujettir aussi facilement, corneille ou pas.
Tout ceci s’est passé il y a fort longtemps, maintenant, ma vie s’achève maintenant, j’ai vécu plus d’un siècle et coupée du nectar des Arbres Sacrés, mes forces déclinent et mon cher Afalku a rejoint ses ancêtres depuis longtemps. Je ne peux finir de raconter les souvenirs de cette rencontre qui changea ma vie sans évoquer l’oasis de Bouméké où je suis arrivée à l’âge de vingt cinq ans pour y passer la majeure partie de mon existence et fournir un enfant à la Lignée, le devoir, le destin. Une existence heureuse que l’ancienne guerrière des Ombres de la Sylve que j’étais ne renie pas une seconde. Il fallut une semaine à la caravane pour joindre l’oasis depuis le campement provisoire établi dans celle de Ferkla. Une semaine éprouvante pour moi, pas habituée à ces longueurs marches sous une chaleur extrême, les nuits glaciales du désert, et cela même si un maximum d’attentions m’étaient prodiguées en tant qu’invitée d’honneur et future épouse de l’Amrhar, car c’est ce qui fut décidé rapidement, il ne fallut que trois jours à Afalku pour demander ma main. Les mœurs et les unions étaient tellement libres dans la Sylve que la demande me surprit presque. La profondeur de ses yeux verts m’avait déjà conquise, tout comme la sincérité de son regard. Il avait juste fallu au Destin qu’il m’amenât là. Le Destin, le Vieux, la grive, qu’importe, peut-être, fus-je en quelque sorte récompensée d’avoir choisi cette voix, comme si lui et moi, avions eu le choix …
Bouméké, qui est devenue le centre de ma destinée, est une oasis d’importance moyenne auquel on accède par une piste en permanence surveillée par des guerriers après plusieurs jours d’une longue marche à travers dunes et rocaille, de n’importe quelle direction que l’on vienne. Le village lui-même est dispersé à la lisière des jardins et abrité des vents secs par ces gros rochers défiant les lois naturelles de l’équilibre ; ainsi l’on n’y ressent pas la chaleur de la hamada et du désert qui cernent l’oasis de toutes parts.
Une source abondante et fraîche irrigue les dattiers, les cultures céréalières et de légumes agencées en petites rectangles harmonieux. Quant aux habitations, ce sont des cases rondes, parfois au toit conique, faites d’un assemblage de palmes de dattiers tressées, d’autres, d’un torchis mélangeant de la terre et des végétaux séchés et des murets de pierre ou de bois mort en délimitent l’intimité des familles tout en servant d’enclos pour quelques animaux domestiques. Afalku, lui, en digne homme du désert, préférait que nous habitions une Khaïma, une vaste tente fabriquée en peau de dromadaire. Au centre trône un âtre pour le feu pour du soir car les nuits peuvent être glaciales dans le désert, le sol est garni de tapis et de peaux sur lesquels par tradition l’on se déchausse en entrant. Des lampes à huile, des tables basses entourées de coussins avenants sont disposés un peu partout et des tentures aux couleurs chaudes garnissent les parois. C’est là qu’Afalku reçoit les chefs de différents clans amis se décident du départ des caravanes, des patrouilles et surveillance à organiser, mais avant tout, l’on y parle commerce et s’y échangent des nouvelles de l’extérieur avec des voyageurs de passage… Quant à moi, durant toutes ces années, ne manquant de rien, je m’initiai d’abord à la langue du désert, le hassaniya qui était un mélange de plusieurs vieux dialectes du nord d’Ifrikiya, et à sa calligraphie aussi belle que complexe. Je m’adonnais aussi au tissage, à la culture de fleurs, autant d’activités diverses qui emplissent toujours agréablement mes journées, sans parler de mes enfants et plus tard de leurs enfants. Et puis, j’écris, essayant de coucher les souvenirs de mon voyage et de notre rencontre sur du papier troqué à un marchand du Nord lors de son passage ici. Nous n’étions pas si isolés pour qui voulait nous trouver avec de bonnes attentions.
Cependant ce que je préférais c’était les longues journées de chasse dans la hamada. Sur une large bordure de l’oasis, il poussait une végétation d’arbustes de hauteurs divers, des buissons d’épineux aux formes étranges, sculptés tant par les vents que par le sable qu’ils soulèvent. Armés d’un arc et d’un long poignard, nous partions à cheval, des entiers rustiques et râblés, rapides et puissants, que la traque semblait exciter autant que nous. Mais dans cet environnement le gibier était rare, composé de gros lézards, parfois d’un renard des sables ou encore plus rarement un félin égaré ressemblant aux guépards de la Sylve. De fait, un agréable intermède aux activités champêtres qui avait surtout le mérite de nous isoler du monde. D’être nous, face au silence et à l’immensité du Vide.
Parfois, les enfants de mes enfants qui courent dans mes jambes à perdre haleine en riant, me dissuadent de me demander si je n’ai pas rêvé tout ça, ma vie. La grive aussi, une fois, il y a longtemps, juste après mon mariage, qui est apparue à ma fenêtre, me rappeler le devoir que j’avais de préparer le premier de mes enfants, fille ou garçon, à son départ. Une déchirure. Le Destin. Le Vieux avait parlé de lignée, une fois. Il m’aura coûté cher, le destin. Un voile sombre et triste dans une vie de mère que de voir partir son fils loin de soi, fonder une famille dans un pays froid et hostile. Le Destin, puis se perdre, avec leur enfant. Nulles traces. Une tempête, ou autre chose, des bêtes sauvages, sûrement. Mektoub !, comme répètent souvent les Hommes du Désert.
- Dis Afalku, tu n’aurais pas un jour, par le plus grand des hasards, rencontré un vieil homme un peu bizarre ?
- Bonnet coloré, longues tresses et collier de barbe, avec un vieux bâton ? Si, pourquoi ?
Notes pour le lecteur :
La il-ah ill-al-alaaah ! c’est l’adhan, l’appel à la prière des fidèles. Il dit : Il n’y a de Dieu que Dieu. J’atteste que Mohammed est son prophète. Viens à la prière. Viens à la félicité. Dieu est grand (2 fois). Il n’y a de Dieu que Dieu.
Souvenirs de mon arrivée au Désert de la Mer du Milieu.
Tamchta la Sylve, Oasis de Bouméké. Année 243 des Grands Bouleversements.
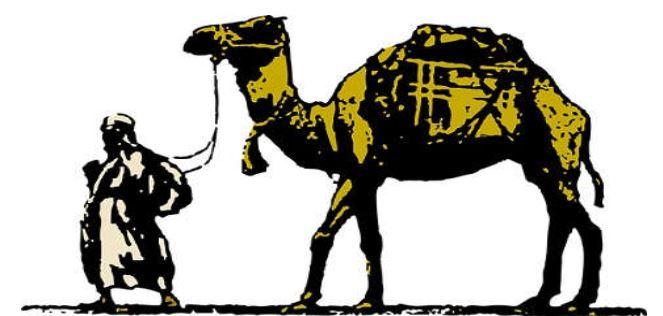
Date de dernière mise à jour : 14/06/2025
Ajouter un commentaire
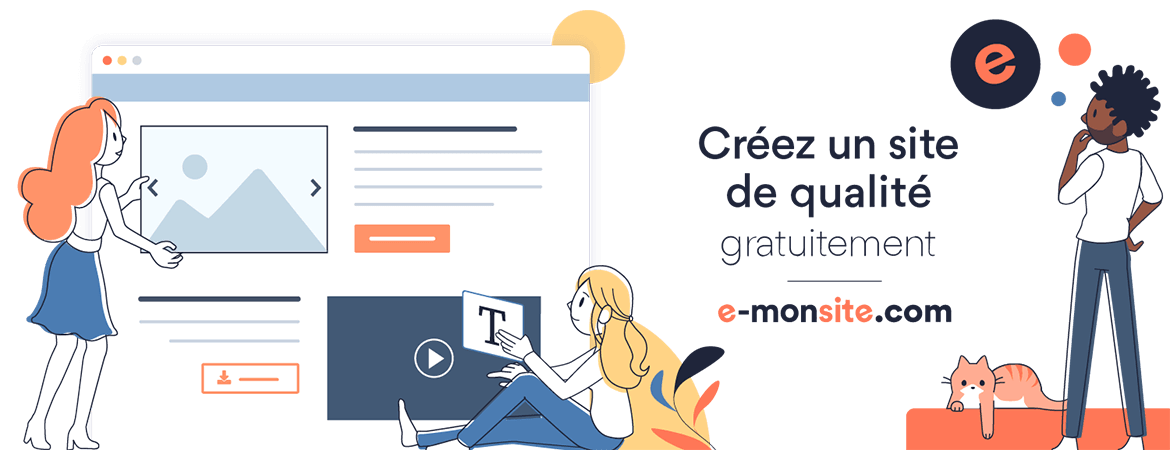












 ème visiteur
ème visiteur



